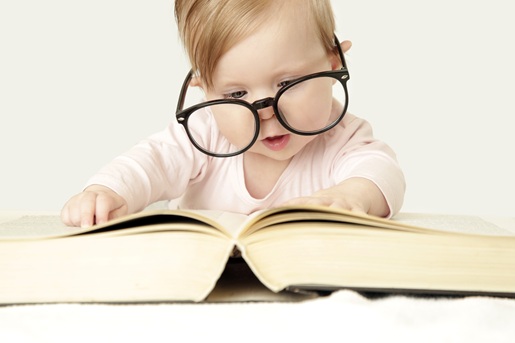Et si la prochaine innovation révolutionnaire de votre entreprise venait … d’un cerveau atypique que vous n’avez pas encore su reconnaître en interne ?
En 2025 en effet, l’innovation n’est plus réservée aux start-ups ou aux grands groupes disposant de directions R&D hyper-staffées et aux méthodes disruptives. Elle émerge surtout des organisations qui ont su créer un terreau fertile à la pensée divergente. Autrement dit, celles qui intègrent et valorisent la diversité cognitive, à commencer par la neurodiversité (HPI, TDAH, DYS, TSA…).
Ces profils atypiques n’ont pas seulement un autre regard. Ils observent, pensent, combinent, analysent, décodent le réel différemment. Et c’est précisément cette différence radicale qui génère des idées nouvelles, qui permet de briser les silos mentaux pour mettre en œuvre ces idées, et qui ose l’exploration là où la majorité suivent les schémas établis.
Dans mon précédent article paru le 18 juillet 2025, je vous expliquais comment la neuroinclusion peut conduire à booster votre productivité d’entreprise, ce nouvel article détaille son impact sur votre potentiel d’innovation.
🚀 L’innovation : un impératif stratégique
Nous sommes entrés dans une économie de l’agilité. Selon PwC, 61 % des dirigeants considèrent l’innovation comme leur priorité stratégique absolue d’ici 2026. Pourtant, beaucoup s’en remettent encore à des méthodes d’idéation standardisées, ou à des investissements technologiques massifs sans remettre en cause leurs pratiques collaboratives ou managériales.
Or, comme le souligne l’OCDE, les principaux freins à l’innovation ne sont pas techniques : ce sont des freins humains, culturels, organisationnels. Autrement dit, il faut des cerveaux différents pour ouvrir d’autres voies.
Diversité cognitive : de quoi parle-t-on ?
Contrairement à la diversité socio-démographique, la diversité cognitive porte sur les manières de penser, d’apprendre, de traiter l’information, de décider ou de percevoir.
Elle s’incarne notamment dans les profils neurodivergents :
- Les HPI, avec leur pensée arborescente (*), leur rapidité d’observation et de pensée, leurs capacités d’analyse et de synthèse, et d’intuition stratégique.
- Les TDA/H, porteurs d’une énergie créative, d’une pensée en dehors du cadre
- Les DYS, dont les compensations cognitives stimulent la visualisation spatiale, à l’origine de d’une grande inventivité face aux problèmes nouveaux et complexes (pour les dyslexiques par exemple)
- Les personnes autistes, dotées d’une grande rigueur analytique, d’une pensée logique innovante, et d’une hypersensibilité à certains signaux faibles.
Attention : il ne s’agit pas d’ériger ici un modèle héroïque. Ces profils ont aussi besoin d’un cadre de travail spécifique : sécurité cognitive, reconnaissance, et management ajusté. Sans cela, leur créativité s’éteint ou ne peut pas s’exprimer.
(*) Ou plus précisément des connexions neuronales entre les différentes aires cérébrales plus nombreuses, fluides, et rapides que la moyenne.
Une créativité fondée sur la divergence, la disruption et la complexité
Les profils neurodivergents partagent souvent leurs aptitudes à générer des connexions inattendues entre des domaines ou sujets éloignés. Ils posent des questions impertinentes (*), celles qui dérangent, mais qui font aussi progresser.
👉 Ce que certains tentent de faire ponctuellement par des méthodes d’idéation telles que l’association d’idées ou d’images, est un processus naturel permanent chez les profils neuro-atypiques.
(*) Impertinent se comprend de 2 façons : non pertinent, au sens de sans rapport avec le sujet concerné. Or c’est parfois de cette incohérence apparente que naissent les plus grandes idées. Mais il signifie aussi audacieux, hardi, voire insolent. Or c’est cette audace et cette hardiesse qui permettent de sortir des sentiers battus.
Ils sont globalement :
- Moins inhibés cognitivement face à l’inconnu
- Plus aptes et prompts à penser et sortir du cadre, pour inventer d’autres manières de faire
- Moins soumis aux biais cognitifs. Par exemple le biais de confirmation : tendance à valider ses opinions auprès des instances qui les confirment, et à rejeter d’emblée celles qui les réfutent. Ou encore l’effet de simple exposition : tendance à affecter un avis plus positif à une personne ou une idée à laquelle on a déjà été préalablement exposé. Ou enfin le biais d’appel à la tradition : tendance à considérer que l’ancienneté d’une idée ou d’une assertion renforce sa véracité ou sa valeur.
💡Dès 1995, l’étude de Bonnie Cramond (University of Georgia) par exemple montre que 50 % des enfants TDAH figurent dans le tiers supérieur des scores de pensée créative au Torrance Test. Et dans le décile supérieur, 32 % d’entre eux.
Dans les entreprises, cette créativité se traduit concrètement par :
- Des suggestions récurrentes d’optimisation sur le terrain
- Des solutions qui éclairent les angles morts, et permettent d’éviter des échecs, très nombreux en innovation
- Des innovations d’usage ou de service inattendues
- Une capacité à percevoir les signaux faibles en amont, et ainsi être en mesure d’identifier les attentes du marché et d’y répondre avant tout le monde.
Une meilleure prise de décision grâce aux frictions constructives
Une étude menée par Cloverpop, relayée par Deloitte, montre que les équipes diversifiées (sur tous les aspects, en particulier cognitif) prennent de meilleures décisions dans 87 % des cas. Pourquoi ? Parce que la diversité cognitive :
- Favorise la confrontation d’idées
- Réduit les biais collectifs (comme le biais de confirmation – cf plus haut)
- Renforce la rigueur des processus de validation
Les profils neuro-atypiques challengent les consensus mous. Ils sont souvent les premiers à alerter sur les incohérences, à défendre une idée impopulaire mais stratégique, ou à identifier des risques systémiques ignorés par d’autres (au point parfois de passer pour des Cassandre – cf cet autre article à ce sujet).
Cette dynamique crée une culture de décentrage indispensable à l’innovation.
Des exemples concrets de gains d’innovation grâce à la neurodiversité
Chez SAP, le programme « Autism at Work » a permis à un collaborateur TSA d’identifier un bug informatique majeur, avec un impact économique estimé à 40 millions de dollars évités (source : CultureAmp).
Chez Microsoft, le programme « Neurodiversity Hiring » a stimulé la conception inclusive de ses outils numériques, tout en faisant progresser l’innovation interne sur les tests qualité et la cybersécurité.
Chez JPMorgan Chase, les collaborateurs neurodivergents engagés dans des fonctions d’analyse de données se sont révélés 140 % plus productifs que la moyenne, tout en développant de nouvelles méthodologies d’analyse plus efficaces.
Chez UbiSoft, on a une politique de recrutement et d’intégration spécifique des neuro-atypiques dans le but clairement affiché de doper la capacité d’innovation, si stratégique dans le monde du jeu vidéo.
Un terreau managérial à transformer
Comment révéler cette richesse cognitive ? C’est d’autant plus crucial de se poser cette question que les profils neuro-atypiques eux-mêmes n’ont pas conscience le plus souvent de leur talent original en matière d’innovation, ils se perçoivent comme les autres, et en tout cas, pas plus doués que les autres en la matière.
De plus, quand ils ont conscience de leur talent spécifique, ils ont tendance à le masquer car leur idées et innovations ne sont pas toujours bien comprises et acceptées, et parfois mêmes sont à l’origine d’une certaine jalousie en interne.
Pour que cette richesse potentielle s’exprime, il est donc nécessaire de créer un terreau managérial favorable, ce qui veut dire concrètement :
- Des réunions bien structurées, où chacun peut s’exprimer à son rythme
- Des temps de concentration protégés
- Des formats de brainstorming adaptés à la pensée visuelle ou écrite
- Un droit à la différence assumé dans le collectif
Les managers doivent de leur côté :
- Être formés aux fonctionnements cognitifs atypiques pour être en mesure de révéler leurs talents enfouis
- Encourager à faire s’exprimer ces atypies, plutôt que de valoriser la conformité
- Donner des feedback précis, contextualisés, constructifs
👉 Un management plus inclusif, c’est un management qui aide les profils neurodivergents, et qui bénéficie à toute l’équipe.
Vers une intelligence collective augmentée
Innover, ce n’est pas seulement inventer des produits nouveaux. C’est penser autrement ensemble. Or la diversité cognitive augmente :
- La créativité collective
- L’aptitude à travailler en mode projet
- La capacité à anticiper les ruptures : or ces ruptures sont de plus en plus grandes, fréquentes, et imprévisibles
Comme le résume bien un rapport de Deloitte (2018) : « Les organisations inclusives sont 6 fois plus innovantes et agiles que les autres. »
Et surtout, elles développent une culture de l’écoute active, du feedback ouvert, de l’expérimentation permanente, qui sont les fondations mêmes de la performance durable.
🎯 L’innovation et l’intelligence collective ont besoin de la neurodiversité
Dans un monde saturé d’informations, d’outils digitaux et bientôt d’IA générative, le vrai avantage concurrentiel sera humain, et plus précisément cognitif.
Pour en savoir plus
Participez à notre prochain webinaire gratuit sur le thème « Quels bénéfices d’une démarche d’inclusion de la neurodiversité pour votre entreprise ? » du mardi 7 octobre à 12h30, que j’aurai le plaisir de co-animer avec deux autres experts en neuroinclusion : Céline Racle-Alarcon et Jenny Augias.
Vous souhaitez bénéficier d’un premier pré-diagnostic de votre situation, en savoir plus sur les actions possibles, ou si vous avez des questions spécifiques :
Et pour ne rien perdre de mon actualité c’est ici.
Cyril Barbé