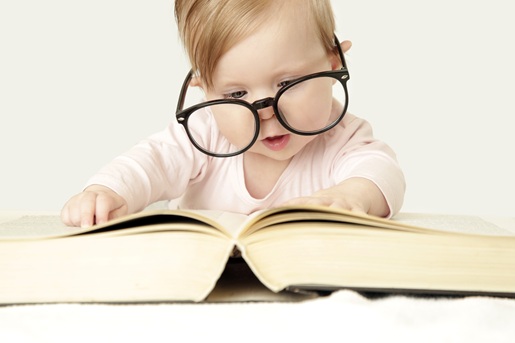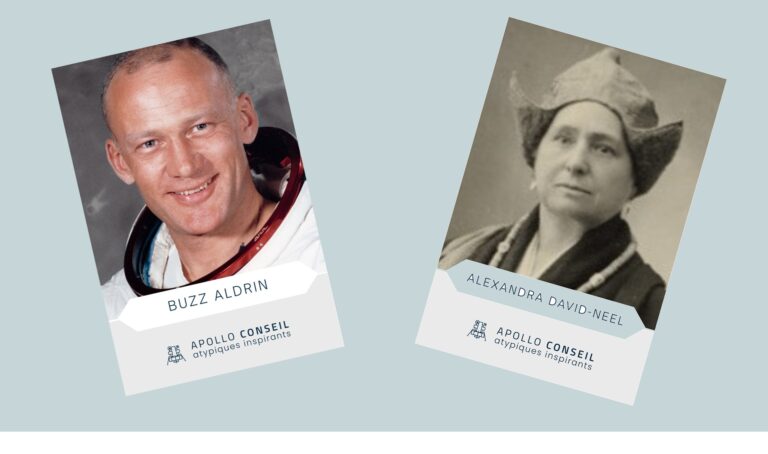Ma confrère et partenaire Céline Racle-Alarcon, avec qui je co-anime des webinaires sur ce sujet, a récemment fait paraître un article que je trouve très intéressant sur l’évolution de l’affichage par certains profils neuro-atypiques, de leur spécificité auprès de leurs employeurs, y compris lors de phases de recrutement. J’ai le plaisir de vous le partager ici.
Cyril Barbé
Mon expérience en entreprise m’a permis de constater qu’au cours des cinq dernières années, de plus en plus de candidats osent évoquer leur handicap, parfois dès la phase de recrutement.
Après plus de 15 ans passés en ressources humaines, j’ai pu constater, que depuis quelques années, de plus en plus de collaborateurs commencent à aborder leur neuroatypie dès leur arrivée en entreprise — voire dès le recrutement, surtout chez les jeunes générations. Rien d’un raz-de-marée, bien sûr car beaucoup de salariés préfèrent encore taire leur singularité, mais ce phénomène est révélateur d’une tendance de fond plus globale.
Pour quelles raisons certains osent plus s’afficher qu’avant ? Pourquoi toutes les entreprises sont concernées ? Quelles conséquences pour elles ? Comment se préparer à ce mouvement de fond, et même en faire une opportunité ?
Découvrez-le en lisant cet article.
Pourquoi ose-t-on parler davantage de sa neuroatypie ?
📌 Une meilleure connaissance des troubles du neurodéveloppement (TND) et un diagnostic plus précoce.
Depuis quelques années, la sensibilisation sur les TND s’est accrue. Le repérage précoce est encouragé : il est même devenu une priorité de santé publique à travers la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027, qui vise à améliorer l’identification, l’accompagnement et l’inclusion des enfants concernés. Une mention existe désormais dans le carnet de santé pour orienter les parents, et des plateformes de coordination et d’orientation (PCO) permettent une intervention précoce dès la suspicion de TND entre 0 et 6 ans.
Ainsi, les diagnostics peuvent être posés plus tôt : dès 5 ans selon la Haute Autorité de Santé (HAS) pour le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH), et le plus souvent dès 2 ans pour l’autisme selon la Fédération française de psychiatrie et la HAS. Les jeunes apprennent donc à vivre avec leur trouble très tôt, ce qui peut les amener à en parler plus naturellement une fois adultes.
Par rebond, certains parents adultes se font eux aussi diagnostiquer suite l’évaluation de leur enfant, en se reconnaissant à travers lui, et prennent donc mieux ce sujet en considération pour eux-mêmes. Combien de parents me disent lors d’un premier contact se reconnaître dans le comportement de leur enfant. Et ces adultes s’assument d’autant mieux que leurs enfants le font aussi.
📊 Des chiffres qui confirment la tendance
- D’après le rapport publié par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2023, Les étudiants en situation de handicap présentant des troubles du langage et de la parole sont les plus représentés (24.4%).
- Ces jeunes bénéficient souvent d’un PPS – Projet Personnalisé de Scolarisation, qui ouvre ensuite automatiquement vers une RQTH – Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé – entre 16 et 20 ans, notamment pour les alternants.
- Concernant les RQTH, les MDPH – Maisons Départementales des Personnes Handicapées – ont accordé 697 500 prestations en 2023 selon le CNSA, soit une hausse de 2,8 % par rapport à 2022.
🌟 De plus en plus de personnalités qui libèrent la parole
Les troubles du neurodéveloppement se démocratisent aussi dans les médias : plusieurs personnalités connues choisissent désormais d’en parler ouvertement.
- L’ancien ministre de la Santé Olivier Véran ou la chanteuse Louane ont évoqué leur TDAH
- La chanteuse Sia ou l’acteur oscarisé Anthony Hopkins ont partagé leur diagnostic d’autisme.
- L’acteur réalisateur Franck Gastambide a parlé de sa dyslexie, de son HPI et de son hypersensibilité en 2022 dans l’émission C’A Vous.
Toutes ces prises de parole contribuent à lever le tabou, à normaliser le sujet et à encourager de nombreux jeunes – ou moins jeunes, à assumer plus facilement leur singularité au travail.
Ces modèles contribuent aussi à renforcer un autre phénomène de fond : beaucoup des personnes concernées ne se perçoivent pas comme porteuses d’un handicap, tant elles ont su ou dû s’adapter pour et trouver des tactiques personnelles pour atteindre ce qu’elles considèrent comme une « vie normale ». C’est d’ailleurs à l’image plus généralement des personnes concernées par les handicaps moteurs ou mentaux : tout est question de perception.
💬 Des salariés qui s’expriment
Chez Cdiscount, par exemple, la Handi Team témoigne de l’importance de pouvoir parler de sa singularité sans crainte. Les salariés mettent en avant l’évolution des mentalités, l’idée que la différence peut être une force, et la conviction qu’aucun handicap ne devrait constituer un frein à l’emploi. Ces paroles illustrent qu’un climat d’écoute et d’ouverture permet aux collaborateurs de partager plus sereinement leur expérience.
En synthèse, ces constats (diagnostics plus précoces, hausse des RQTH, témoignages médiatiques et prise de parole de salariés) traduisent une évolution : les jeunes générations assument davantage leur singularité. Ce phénomène se retrouve aussi dans les entreprises, où les jeunes collaborateurs évoquent plus facilement leur atypie auprès de leurs employeurs.
Cette évolution vers une parole plus assumée des collaborateurs neuroatypiques n’est cependant pas une généralité, de nombreux salariés continuent à garder leur singularité discrète. Selon un sondage Harris Poll-Underground, environ 60% des personnes neuroatypiques préfèrent taire leurs spécificités au travail.
Mais le mouvement de fond est bel et bien engagé.
Pourquoi toutes les entreprises sont concernées ?
La neuroatypie touche environ 20% des salariés européens, si l’on inclut les TND et le HPI. Certes, ils sont plus que la moyenne sans emploi, mais on peut estimer que 15% de la population active est concernée. Et comme une bonne part de ces collaborateurs sont soit non diagnostiqués, soit dans une logique de masquer leur différence, 1 collaborateur sur 6 en moyenne au sein des entreprises est concerné, et dans plus de la moitié des cas, l’employeur n’en a pas conscience.
Ces spécificités concernent toutes les fonctions et tous les niveaux de l’entreprise : depuis les collaborateurs opérationnels sur le terrain, jusqu’à la direction, en passant par tous les niveaux de management. Elles s’étendent aussi à tous les domaines d’activité.
Les neuroatypiques sont donc partout : c’est ce que nous, Jenny Augias Jourdannet, Cyril Barbé et moi-même, avons constaté au quotidien avec les centaines de clients que nous avons accompagnés ou eu en contact direct depuis plusieurs années.
Quelles conséquences de cet affichage pour votre entreprise ?
Votre entreprise risque de plus en plus de se retrouver face à des collaborateurs – nouvelles recrues ou pas – qui assument leur neuroatypie … et qui attendent écoute, compréhension et adaptation de leur fonction, leurs missions, leur contexte de travail. Il ne sera alors plus possible de fermer les yeux ou de faire « comme si de rien n’était ».
Les profils neuroatypiques en effet ont des besoins spécifiques pour pleinement s’épanouir, mais aussi ont des talents très originaux et très pertinents dans une société de plus en plus chaotique.
Comment vous préparer à ce mouvement de fond, et en faire une opportunité ?
- En sensibilisant et formant vos équipes.
- En comprenant les besoins spécifiques.
- En mettant en place un environnement de travail favorable.
Vous souhaitez en savoir plus, alors n’hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire du mardi 7 octobre à 12h30 que j’aurai le plaisir de coanimer, avec Jenny Augias et Cyril Barbé : « Quels bénéfices d’une démarche d’inclusion de la neurodiversité pour votre entreprise ? »
Céline Racle-Alarcon